Episode 1 : Mémoires de mon grand-père, qui débute au Mans…
| Petits passages et anecdotes sur le mémoire de mon grand-père Francisque, Jean, Joseph RICHARD (né le 12 Octobre 1908 au Mans)– épisode 1 – |
 |
En la nuit du 12 octobre 1908, vers les trois heures du matin, au numéro 110 du boulevard de la République, dans une pièce unique donnant sur une cour intérieure grossièrement pavée à la clarté jaunâtre et précaire d’une lampe à pétrole fumeuse et nauséabonde, naissait, du ventre de Marie Mathieu née RAGEOT, un gros bébé hurlant que la sage-femme remit sans ménagement dans le tablier tendu par une voisine bénévole, Mme NICOLLE.
Quand l’effervescence fut calmée, les bassins vidés dans la rigole qui coulait devant la porte, la mèche de la lampe mouchée, l’eau épongée sur le carreau et la mère enfin apaisée sur le lit de fer retapé à la hâte, on reprit, afin d’en finir une bonne fois pour toutes, la vieille discussion sur les prénoms à donner à l’enfant.
L’appellerait-on Julien, comme le grand-père maternel mort depuis une quinzaine d’années ou Francisque comme cet homme ému et maladroit qui ne savait guère quelle attitude adopter devant ce miracle d’une naissance qui l’intronisait père de famille, ou bien Alfred comme le cousin riche et éventuellement tutélaire.
Finalement ce fut sous les vocables de Francisque (bien préciser Francisque, Julien MATHIEU que le lendemain, sur les registres d’état-civil de la Mairie du Mans (Sarthe) on inscrivit, il y a soixante-dix ans, celui qui écrit ces lignes. Mais, très tôt, pour me différencier de mon père qu’on appelait d’ailleurs communément Franci, je devins Julien Mathieu.
Cette intervention de prénoms légaux allait, plus tard, me valoir quelques mécomptes dans mes rapports avec les diverses administrations auxquelles j’aurais à faire au cours de ma vie de citoyen.
Pour l’heure, choyé plus que de convenance par une mère toujours inquiète et une grande mère maternelle certes plus cohérente dans les diagnostics dont elle sanctionnait mes colères affamées ou mes apathies repues, je poussais, jeune plante vivace, à cause ou en dépit d’excès de soins et d’une étouffante tendresse.
J’ai retrouvé dans mes archives familiales un ticket de pesée indiquant qu’à cinq mois et demi, mon poids atteignait 7 kilos 200, ce qui n’était pas si mal et dénotait chez le sujet, une robuste santé.
Néanmoins la moindre montée de température, la plus légère accélération du pouls que mon père, qui avait été infirmier durant son service en Algérie, tâtait au jugé, les yeux au plafond, créait dans la maisonnée, une dérisoire panique. On ne lésinait pas sur les symptômes ; c’était la méningite, le croup, la pneumonie qu’on envisageait d’abord comme affection possible, sinon probable.
Quand il était là, mon père courait Place de l’Eperon chez le docteur Mordret qui m’avait pris en charge puis chez l’herboriste Mainguait, de la rue Nationale que ma grand-mère s’entêtait à appeler la rue Basse. Le médecin affirmait que je n’avais rien qu’un gros rhume ou qu’une petite indigestion et rédigeait une ordonnance anodine.
Le Mans – Place de l’Eperon
Quinze mois après moi, me naissait une petite sœur qu’on prénomma Madeleine ; mais ma mère avait dépensé pour moi tant d’amour exclusif que ma sœur fut toujours un peu lésée de tendresse. Elle avait un bon fond et n’en fut pas jalouse.
Madeleine eut, durant les quarante années qu’elle vécut, une existence effacée. Le monde n’était pas à sa mesure. Elle n’y était pas destinée. A vingt et un an, contre le gré de notre mère, elle entra au noviciat des franciscaines en la communauté des « Châtelets » près de Saint Brieuc. Après six mois, elle en revenait. Sa santé, déjà fragile ne lui permettait pas de suivre la règle. Par la suite, elle contracta une sorte de mal de Pott aggravé d’une hypertension incurable qui la traîna d’hôpital en hôpital, de maison de repos en centre hospitalier, jusqu’à sa mort qui nous désespéra longuement, ma mère et moi.
Je n’avais pas trois ans quand enfin, mes parents purent quitter le pauvre rez-de-chaussée où j’étais né pour un logement plus décent sis dans le quartier de la Gare. Les cinq que nous étions s’y sentirait moins à l’étroit. Il était d’un aspect plus convenable. Ses abords avec, en face, bordée d’un long mur de pierre, une grande propriété où dépassaient des arbres imposants, étaient plus salubres que la « courée » qui m’avait vu naître. Mon père était à vingt petites minutes du dépôt des machines, son lieu de travail et ma grand-mère, pas beaucoup plus loin de la vieille église de la couture qu’elle allait fréquenter avec beaucoup de fidélité.
Le Mans – Eglise de la Couture
Située entre deux voies à forte déclivité, les rues de Bel-Air et de Wagram qui descendaient de l’avenue Thier vers le Bourg-Belé, la rue de Navarin où nous allions habiter durant une douzaine d’années comptait, en sa première partie (l’autre se terminant de trois à quatre cents mètres plus loin sur la rue de Fleurus) une quinzaine de numéros tous impairs.
Notre logement qui portait le chiffre 9 était, parmi d’autres à peu près semblables une de ces constructions locales quasi centenaires dénommées maisons mancelles.
Au rez-de-chaussée, sur une cave à vasistas où l’on entreposait le charbon et où bricolait notre père, était deux pièces. L’une donnait sur la rue. Mes parents y couchaient dans des meubles modern-style achetés à crédit chez Dufayel. Au-dessus d’un crucifix au bénitier toujours vide pendait un étrange tableau dans son cadre tarabiscoté représentant une petite fille à la mode du troisième Empire. Un large accro crevait la toile à l’un de ses angles. Je n’ai jamais su les origines de cette peinture dont, au surplus, nul d’entre nous ne se souciait.
La deuxième pièce où menait un corridor desservant l’entrée du logis, donnait d’autre part sur un jardin potager, on y venait par un perron égayé des branches noueuses d’une odorante glycine. Dix marches de pierre usée permettaient d’accéder à une courette coiffée de vigne vierge, des moineaux piailleurs s’y ébattaient aux beaux jours ; au fond du jardin « trônaient » les cabinets, édicule campagnard qui chaque année un curage dont le relent affectait toute une partie de la journée, l’entourage ; mais cette opération sanitaire constituait pour nous, les gosses, une étonnante distraction.
Le matin, attelée de deux chevaux placides, une machine à vapeur avec son lourd volant de fonte sa bielle aux mouvements presque humains, son piston au joli bruit de soie froissée et ses deux petites boules régulatrices qui tournaient en s’écartant, se rangeait devant chez nous ; elle était accompagnée du réservoir à vidange. Enclenchées à la base de l’énorme tonne, des tuyaux enclavés l’un dans l’autre, formaient un long boa qui, par le corridor, la cuisine, le jardin, allait plonger sa gueule aspirante dans la fosse. Le mécanicien avait mis en marche la pompe à vapeur et la puante opération durait toute la matinée cependant que le servants, assis au bord du trottoir, mangeaient tranquillement et sans dégoût leur casse-croûte matinal ce qui nous étonnait bien peu.

















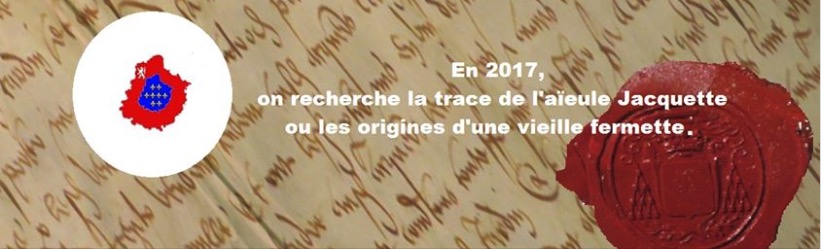 Généalogie en Sarthe 72
Généalogie en Sarthe 72

Je découvre ce site. Très intéressant. Merci Sylvie