Episode 2 : Mémoires de mon grand-père, qui débute au Mans…
| Petits passages et anecdotes sur le mémoire de mon grand-père Francisque, Jean, Joseph RICHARD (né le 12 Octobre 1908 au Mans)– épisode 2 – |
 |
Après leur départ, ma grand-mère, armée d’une pelle et d’une balayette ramassait le crottin des chevaux pour fumer les planches de légumes.
Notre jardin s’étendait sur une quinzaine de mètres de long séparé des enclos voisins par des barrières de bois à claire-voie qu’on appelait des « palis », barrière toutes symboliques qui permettaient, d’un locataire à l’autre, les conversations familières sur le temps qu’il ferait, la pousse des légumes, le coût de la vie ou les potins du quartier.
De ce jardin, j’ai aimé le magnifique lilas qui fleurissait au printemps et parfumait, surtout quand il avait plu, la cour.
Au long des allées latérales poussaient, avec des fraisiers anarchiques, des touffes de myosotis que copiait, sur la charlotte de ma petite sœur, une frange savante et factice de ces minuscules étoiles de terre.
Avec la glycine du perron, les myosotis des plates-bandes, les lilas que je préférais, mon enfance fut comblée.
C’était aussi au jardin qu’entre voisins on se rencontrait et qu’on devisait. A gauche, M. et Mme CLOTTEAU me paraissaient âgés pour mes huit à dix ans. Leur fille faisait l’école à l’externat Saint-Joseph ; une certaine année, ma sœur l’eut pour maîtresse. Sur notre droite, vivait une famille Pichon également sympathique. Le père était charretier aux établissements CARREL ; sa femme, à la suite de je ne sais quel accident, n’avait qu’une jambe et se déplaçait à l’aide d’un pilon et d’une béquille ; mais il fallait voir avec quelle adresse elle descendait les marches de son escalier semblables au nôtre. Une fille unique, Odette complétait cette honnête famille. Elle devait être un peu plus âgée que moi. Contre la palissade mitoyenne poussaient, de son côté, des choux hauts sur tige dont elle convenait que c’était des élèves auxquels elle faisait la classe. D’une baguette sévère, elle les fustigeait lorsqu’ils étaient censés ne pas répondre correctement à ses questions.
– Odette ! Tu n’as pas bientôt fini d’abîmer les feuilles de choux ? Si ton père te voyait ! – C’était Mme PICHON qui morigénait sa fille.
Par beau temps, envoyés jouer dehors par notre mère : « Allez ! Débarrassez moi le plancher », nous inventions des jeux impossibles.
Il en fut qui faillirent mal tourner. Chaque année, notre père se voyait attribuer un lot de traverses de chemin-de-fer qu’en prévision de l’hiver, il débitait, non sans difficultés, dans notre cour.
– Regarde dis-je un jour à ma sœur Madeleine, regarde comme je suis fort.
Je soulevai alors une pièce de ce bois dur et lourd et tentai de l’élever au-dessus de ma tête, mais il était réellement si lourd que je le laissais choir assez brutalement. Ma sœur fit bien un pas en arrière mais elle ne put éviter le choc de mon haltère improvisée qui l’atteignit à l’épaule. En larmes, elle courut se réfugier auprès de notre mère qui, fort justement me traita de sale gamin.
Une autre fois, je voulus enseigner à ma malheureuse compagne de jeux un exercice que j’avais appris des grands et qui m’avait semblé des plus amusants. On se baissait, la tête en avant, aussi près que possible du sol ; on passait ses deux bras entre les jambes, tendant les mains qu’un grand empoignait et tirait à lui d’un geste brusque. Quand l’exercice était réussi, le volontaire se retrouvait debout après un saut périlleux des plus impressionnants. Je voulus faire partager à ma sœur les émotions de cette curieuse gymnastique. J’ignorais seulement que le « porteur », ainsi dit-on, je crois chez les gens du cirque, devait être, en l’occurrence, assez nettement plus grand que son partenaire. J’étais à peine plus haut que ma sœur laquelle, pleine de confiance en son grand frère, se mit en position. Je lui pris dons les deux mains et tirai.
Le malheur voulut pour elle qu’en raison de nos deux tailles sensiblement égales, elle ne put compléter correctement son tour et tomba le visage en pleine terre. Par chance, il avait plu et la boue amortit le choc ; mais ma sœur avait les joues affreusement maculées de cette boue qui, pourtant lui avait été bénéfique.
Elle appela sa mère qui la débarbouilla et la consola cependant que, châtiment des plus mérités, je recevais une magistrale paire de taloche dont l’aller et retour fit autant de mal à mon amour propre déjà humilié par mon échec qu’à mes deux joues devenues écarlates.
Cette cour nous inspirait d’autres distractions moins scabreuses et qui requièrent notre naïve collaboration.
Par soucis d’économie, notre grand-mère « baratait » parfois dans un bol, un reste de lait caillé qui, sous l’action de la cuillère vivement agitée, devenait une « lichette » de beurre dont elle se faisait à son petit déjeuner, une tartine.
Nous en avions conclu qu’en battant longuement et fortement l’eau savonneuse du baquet où notre mère avait fait tremper le linge de la famille, nous obtiendrions de la glace. Pourquoi de la glace ? Voilà ce que même encore maintenant, je serais bien incapable d’expliquer. Toujours est-il que nous touillons à coup de bâton l’eau savonneuse que malgré nos efforts nous n’arrivions pas à solidifier. Nous ne réussissions guère qu’à mouiller nos tabliers et à provoquer la juste colère de notre mère qui craignait toujours pour nous, le moindre rhume.
Mais remontons les marches de pierre et pénétrons dans la « cuisine ». On l’appelait ainsi parce qu’en effet c’était là que dardait le poêle, on disait le « fourneau », sur ses quatre hauts pieds de fonte, avec son bain-marie, ses ronds qui s’emboîtaient et sa grille latérale par où l’on attisait les charbons ardents. De chaque côté de la cheminée deux placards enfermaient les casseroles, les plats, les assiettes, es marmites, la cafetière à deux corps et les autres ustensiles nécessaire à notre vie quotidienne.















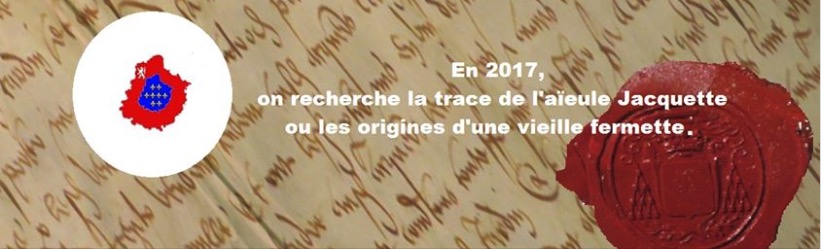 Généalogie en Sarthe 72
Généalogie en Sarthe 72

Commentaires récents